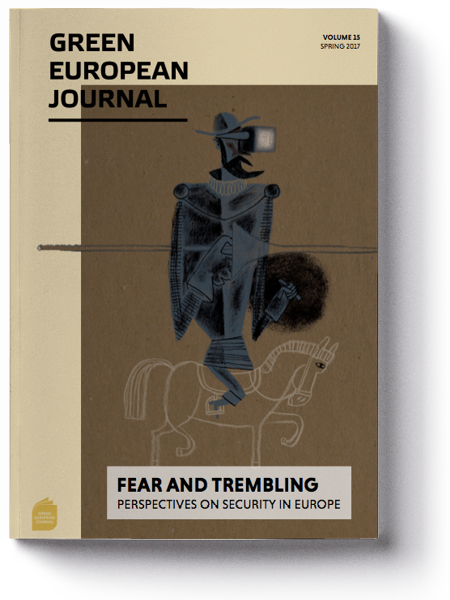Le slogan ‘nourrir l’humanité’ présente l’agriculture industrielle comme unique solution face à la surpopulation et à la faim dans le monde. Pourtant, elle exacerbe le problème, détruisant la nature de laquelle elle dépend, aggravant la pauvreté, et laissant des populations entières, inclus ses propres fermiers, à la merci des fluctuations et spéculations des marchés. Il existe cependant une autre solution – l’agro écologie – qui bénéficie consommateurs, nature, et petites exploitations agricoles.
La population mondiale devrait atteindre 9,7 milliard d’individus en 2050 selon les estimations des Nations Unis. Se poser la question d’une production alimentaire suffisante est évidemment légitime dans un contexte où la faim et la malnutrition sont déjà prégnantes. Incohérente d’un point de vue social et environnemental, l’agriculture industrielle européenne se raccroche vigoureusement à l’impératif moral « nous devons nourrir le monde » afin de justifier ses dérives. Non seulement l’argument du sacrifice vertueux est difficile à croire quand il est utilisé par des multinationales de l’agro-alimentaire, mais il contredit les principes élémentaires de l’anthropologie du développement[1]. Ce slogan est parfois utilisé de bonne foi, mais reflète une vision dangereuse de l’économie rurale et du fonctionnement des sociétés. En réalité, il bafoue les principes de la sécurité alimentaire, qui doit selon la FAO[2] réunir quatre conditions : la disponibilité d’aliments, leur accessibilité pour les populations, la résilience, la qualité. Les agro-industries ne pourraient pas nourrir le monde même si elles le souhaitaient – elles n’y arrivent pas aujourd’hui et en détruisant les outils de production à mesure, elles réduisent encore leur capacité à le faire, les perturbations apportées par le changement climatique aggravant encore cette situation. La destruction des économies rurales locales (ici et ailleurs) n’assure pas la sécurité alimentaire des sociétés paysannes, et il existe au contraire des démarches agricoles bien plus performantes pour permettre à chaque continent et à chaque communauté de se nourrir soi-même.
Une spécialisation au détriment des plus pauvres
Beaucoup pensent que l’Europe exporte principalement céréales, lait et viande vers des pays connaissant des difficultés à produire leur propre nourriture. On constate pourtant qu’une part importante des exportations alimentaires est vendue à d’autres pays industrialisés (un peu plus de 40% selon les derniers chiffres d’Eurostat, le principal acheteur de l’UE étant… les États-Unis), en particulier en ce qui concerne la viande. Plus qu’un flux de nourriture de pays « à l’agriculture efficace » vers des pays « à l’agriculture inefficace », le système agricole industriel se résume essentiellement à une massification et une spécialisation des productions échangées entre pays, provoquant au passage dommages économiques et alimentaires.
Prenons l’exemple de la production européenne de lait et de viande. Elle dépend pour une part non négligeable de protéines végétales (telles que le soja par exemple) importées pour la plupart d’Amérique du Sud. Leur production est avant tout le fait de grands domaines hérités de l’époque coloniale, qui employaient traditionnellement une importante main-d’œuvre. Depuis quelques décennies, l’industrialisation et l’optimisation financière de la production ont conduit à remplacer en partie cette main-d’œuvre par la mécanisation (donc le pétrole), et les produits chimiques. Les anciens salariés agricoles brésiliens ou argentins peuplent aujourd’hui les bidonvilles et souffrent de la faim, et cela bien que le Brésil soit le premier pays exportateur de produits alimentaires vers l’Union Européenne (pour plus de 10 000 millions d’euros par mois). Le Brésil pourrait nourrir très largement sa population actuelle, et pourtant chaque année 12 millions de Brésiliens sont comptabilisés par la FAO dans les 800 millions d’humains souffrant de la faim. Ces 12 millions d’hommes, de femmes et d’enfants sont les anciens salariés agricoles que l’agriculture industrielle des États-Unis, du Canada et de l’UE a indirectement réduits à la misère.
Le dumping alimentaire détruit les économies rurales
Une autre partie de la production des aliments du bétail sud-américaine est assurée par des paysans pauvres, sur des surfaces très réduites ; leur précarité les rend extrêmement dépendants des cours mondiaux. La spéculation agricole – lorsque de grands groupes financiers profitent d’une pénurie relative pour acheter et stocker de la nourriture afin de faire monter les prix – et les règles de l’OMC les obligent à vendre très souvent en-dessous de leur coût de production, c’est-à-dire à perte. 80 % de l’alimentation mondiale est produite par de petites fermes familiales, et pourtant les trois-quarts des personnes souffrant de la faim sont des petits paysans. Ils sont les victimes d’un système qui leur impose de cultiver des produits d’exportation (alimentation du bétail, huile de palme, coton, café, biomasse pour agro-carburants…) et de dépendre de la spéculation sur les cours. Une fois leur récolte vendue, ils n’ont plus de quoi s’acheter à manger.
Ce problème de spéculation et de quotas commerciaux se retrouve dans d’autres productions. L’Europe agricole organise la dépendance de certains pays à ses exportations de blé : grâce aux subventions, le blé européen peut être vendu à perte dans certains pays en développement et empêcher tout développement d’une production locale, incapable de s’aligner sur ces prix « cassés ». Les fluctuations des cours sont alors catastrophiques pour les populations précaires des pays importateurs. Des populations totalement dépendantes des importations pour leur nourriture ne sont pas en situation de sécurité alimentaire.
Une concentration qui ne profite pas non plus aux agriculteurs du Nord
Soyons clairs : il ne s’agit pas non plus ici d’un système qui garantirait la sécurité alimentaire des pays « riches » au détriment des pays « pauvres ». Les agriculteurs en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie…, ne se portent pas bien : maladies professionnelles liées à l’usage de pesticides, dépression et pauvreté. La marge dégagée par le secteur l’est avant tout au profit des agro-industries, de la grande distribution et des spéculateurs. Le nombre d’agriculteurs en Europe a chuté spectaculairement en 50 ans (moins 17 % entre 2005 et 2010 par exemple), concentrant les moyens de production au sein d’exploitations surdimensionnées dépendant essentiellement des banques et des subventions publiques pour leur survie. Lesdits moyens de production sont d’autre part en danger : réduction de la fertilité des sols, disparition des insectes pollinisateurs, pollution des eaux, etc. Quelle production alimentaire à moyen et long terme si les conditions d’exploitation détruisent l’outil de travail – ici la nature ?
L‘accumulation des moyens de production alimentaire, et notamment des semences (l’un des secteurs commerciaux les plus concentrés dans l’Union européenne[3]) au sein d’une poignée de multinationales, devrait être une source d’inquiétude majeure pour les institutions européennes et nationales. Le nombre de variétés[4] cultivées a déjà diminué massivement en conséquence (de 75% durant le 20ème siècle selon la FAO), fragilisant les systèmes agraires et les rendant plus sensibles aux parasites et aux maladies. L’accélération des fusions dans ce secteur (Dupont et Dow, Syngenta et Chem China, Bayer et Monsanto) est extrêmement préoccupante. En proposant des variétés faites pour être utilisées avec des pesticides et des engrais chimiques vendus par ces mêmes entreprises, ces dernières mettent en place un modèle économique qui organise la totale dépendance des agriculteurs vis à vis des intrants qu’elles commercialisent, les mettant en position d’extrême fragilité.
La première cause de la faim est la pauvreté
Il est très clair, comme le reconnait la FAO par la voix de son Directeur-Général que « le modèle de production agricole qui prédomine aujourd’hui ne répond pas aux défis de la sécurité alimentaire du 21ème siècle ». En organisant la dépendance de certaines régions du monde, en imposant les cultures d’exportation qui ne contribuent pas à l’alimentation des populations locales, en permettant la spéculation sur les denrées alimentaires et en favorisant l’accaparement des terres, il crée la pauvreté, et donc la faim. Il faut dissiper la croyance selon laquelle certaines régions du monde seraient en déficit alimentaire : à part en cas de guerre, de séisme ou de catastrophe climatique, la faim est due à la pauvreté, pas à une pénurie structurelle, même si l’adaptation des systèmes agricoles aux changements climatiques est évidemment une question centrale.
La sécurité alimentaire ne se réduit pas à la production en volume
Cette croyance repose en grande partie sur une vision faussée de la sécurité alimentaire, réduite à une quantité globale produite à l’échelle mondiale, alors que nous avons vu plus haut qu’elle impose quatre conditions selon la FAO.
Tout d’abord, il faut bien sûr pouvoir disposer d’aliments en quantité suffisante. Mais les importer de pays tiers conduit à une dépendance et à une absence de souveraineté alimentaire des pays concernés, et n’est possible que pour des pays qui dégagent d’importantes ressources budgétaires d’une autre activité, généralement la production pétrolière.
L’accessibilité à la nourriture produite suppose que la population ait un revenu suffisant pour acheter à son tour les aliments. Nous venons de le voir, la structure des marchés mondiaux ne garantit pas cette condition, bien au contraire, sans compter d’autres facteurs agissent sur les inégalités sociales et économiques.
La résilience signifie que la production agricole doit pouvoir rester « stable » malgré des conditions climatiques changeantes, ce qui n’est possible qu’avec des écosystèmes vivants et en bonne santé. Or, en contribuant pour 18% à 30% des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, en générant une pollution des sols et de l’eau, en accélérant l’érosion des sols et le déclin des insectes pollinisateurs, le modèle agro-alimentaire actuel renforce plus qu’il ne tempère les effets des aléas climatiques sur les rendements. D’un point de vue agronomique, la centralisation et la standardisation de la production de semences et l’uniformisation des techniques sont à contrecourant de la recherche de résilience.
Enfin, reste la question de la qualité. Les systèmes uniformisés de l’agriculture industrielle sont de plus en plus pointés du doigt pour leur mauvaise qualité sanitaire et nutritionnelle, et les dangers potentiels posés par certains de leurs intrants (pesticides, OGM). Le plus récent avatar de ce débat est la polémique concernant l’herbicide glyphosate[5] – déclaré cancérigène probable par le Centre International de Recherche sur le Cancer de l’ONU, il a été innocenté par l’agence européenne EFSA sur la base d’études jamais publiées produites par l’industrie elle-même[6].
Mais la qualité alimentaire dépend également de la diversité des cultures. Or toute la logique de la mal nommée « révolution verte »[7] conduit à appauvrir les systèmes de culture et à focaliser l’alimentation sur un ou deux produits de base (riz, blé, maïs…), ce qui provoque des carences aux conséquences graves. Le cas particulièrement médiatisé du « riz doré » de Syngenta, censé parer au déficit en vitamine A dont souffre un tiers des enfants en bas âge dans le monde, montre les limites de cette logique. Cette déficience pourrait aisément être évitée via une alimentation diversifiée, la vitamine A étant présente dans de nombreux légumes. C’est le passage à la monoculture qui explique en partie l’augmentation de l’occurrence de cette déficience dans le monde, car les systèmes agraires asiatiques traditionnels étaient basés sur une grande diversité de cultures et assuraient une alimentation équilibrée. La solution trouvée par l’industrie biotechnologique est de modifier génétiquement le riz pour qu’il contienne de la vitamine A, et donc d’amplifier l’erreur agronomique initiale. Notons qu’après 20 ans de recherche qui ont couté des milliards d’euros, ce riz n’est toujours pas cultivé en raison de mauvais rendements et d’une disponibilité biologique de la vitamine A insuffisante (la vitamine A du riz GM n’est pas absorbé par le corps).
L’agriculture industrielle n’assure aucunement la sécurité alimentaire mondiale. Elle ne répond (partiellement) qu’au premier critère de la FAO, et encore en créant une dépendance de l’agriculture aux subsides publiques et de certains pays envers d’autres. Elle affaiblit au contraire les trois autres critères !
Des alternatives existent, et sont extrêmement performantes
Le développement, qui ne doit pas être confondu avec la croissance, n’est pérenne et réel que s’il est endogène, c’est-à-dire s’il s’appuie sur les ressources internes des sociétés concernées. Cette règle élémentaire doit évidemment être appliquée à l’agriculture, et de nombreux paysans et agronomes s’y attachent depuis plusieurs décennies[8]. Elle rencontre avec bonheur le critère de résilience. En effet, une agriculture ne peut être résiliente – adaptable aux évolutions climatiques – que si elle est en interaction avec son environnement naturel. Les écosystèmes sont de formidables facteurs de régulation et de sécurisation des agricultures, à condition de les laisser interagir et de ne pas les détruire par l’usage des pesticides.
Le « modèle » conventionnel actuel étant basé sur une sélection centralisée et standardisée des semences, il impose une artificialisation des pratiques, qui est cause d’une fragilité structurelle qui ne peut pas être durable. L’uniformisation de l’agriculture autour de quelques productions standardisées est très peu performante dans les milieux non-tempérés, car elle conduit à perdre une grande partie de l’énergie solaire et à fragiliser les sols. Les monocultures consomment également énormément d’énergie fossile : leur bilan énergétique est négatif, ce qui n’a aucun avenir. Elles détruisent progressivement les sols, par érosion et pollution, ce qui revient à « manger le capital ».
L’agriculture doit être une co-évolution permanente entre un territoire, une société et des techniques, ce qui signifie qu’il ne peut pas exister de « modèle » universel et qu’il est indispensable de valoriser les ressources des paysanneries locales, notamment les semences qu’elles sélectionnent elles-mêmes. Dans la plupart des pays, les rendements agricoles sont considérablement améliorés par les cultures associées (plusieurs plantes cultivées simultanément dans la même parcelle), qui ont le triple mérite d’optimiser l’usage des rayons du soleil, de protéger les sols… et d’assurer une alimentation variée. Toutes ces techniques permettent aux paysanneries de se nourrir elles-mêmes et d’éviter la misère. En maintenant en outre des emplois ruraux et en décentralisant la production, elles permettent l’accès à la nourriture et consolident sa disponibilité.
Ces principes se retrouvent dans les démarches appelées « agriculture biologique » depuis les années 1930, ou parfois « agriculture paysanne » ou « agroécologie » par certains acteurs plus récents. Elles ont fait la preuve de leur efficacité aussi bien en volume qu’en résilience, qualité et accessibilité. Si l’Europe veut lutter contre la faim dans le monde, elle doit les soutenir vigoureusement, ce qui implique de cesser le dumping alimentaire, de mettre fin à l’accaparement des terres, et d’abattre le schéma économique dépendance-spéculation. Autrement dit, elle doit cesser de vouloir exporter massivement, et construire sur son territoire des agricultures autonomes et écologiques. En produisant moins, mais mieux, nous rééquilibrerons à la fois le système alimentaire mondial et nos propres territoires.
Remerciements particuliers à Sara Monsieur
[1] Cf. notamment les travaux de Jean-Pierre Olivier de Sardan, ou la définition qu’en donne Pierre Pradervand : « le développement est un processus par lequel les individus et les communautés se rendent maîtres de leurs ressources, au sens le plus large du terme – autant sociales, culturelles, spirituelles que matérielles – en vue d’améliorer leurs conditions selon des critères qu’ils ont eux mêmes définis ».
[2] United-Nation Food and Agriculture Organisation
[3] Par exemple, 95% du marché des semences de légumes dans l’UE est détenu par 5 multinationales, selon un rapport de 2014 de Ivan Mammana commandé par le groupe Verts/ALE au Parlement Européen
[4] Une variété végétale a un génotype et un ensemble de caractéristiques stables et transmissibles
[5] À la base notamment du désherbant « Roundup ».
[6] Quatre eurodéputés Verts ont demandé l’accès à ces études et sont toujours en pourparlers avec l’EFSA à ce sujet.
[7] Depuis les années 1970, le modèle européen et nord-américain basé sur des semences standardisées, des monocultures, la mécanisation systématique et le recours à des engrais et pesticides, a été diffusé dans le reste du monde sous le nom trompeur de « révolution verte ».
[8] Voir les travaux des ONG comme Agrisud et AVSF, ou de chercheurs comme Marc Dufumier, Miguel Altieri, François de Ravignan, Jules Pretty, etc.